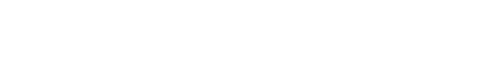Les relations avec le monde juif
concernent notre propre identité.
Le dialogue entre juifs et catholiques a pris une importance croissante depuis le concile Vatican II, achevé en 1965.
L’Église a rappelé son lien spirituel avec la descendance d’Abraham : « Scrutant le mystère de l’Église, le saint Concile rappelle le lien qui relie spirituellement le peuple du Nouveau Testament à la lignée d’Abraham »[1].
Ce document est un tournant historique après l’hostilité qui a prévalu pendant des siècles entre juifs et chrétiens. Au départ, l’Église naissante était un courant messianique au sein du monde juif. Les premiers « chrétiens » étaient donc à la fois juifs et chrétiens. Le judaïsme de cette époque était ainsi traversé par des désaccords théologiques profonds. L’Église a ensuite rapidement accueilli beaucoup de non-juifs (des Grecs et des Romains). En quelques siècles, les désaccords, qui étaient internes au milieu juif, se sont transformés en opposition entre deux groupes de plus en plus éloignés. D’un côté s’est développé le judaïsme synagogal et de l’autre le christianisme.
Le théologien Fadiey Lovsky a bien résumé ce mouvement historique en évoquant le fait que les premiers chrétiens venant du monde gréco-romain ont d’abord dit : « Israël, c’est nous aussi » puis « Israël, c’est nous » et enfin « Israël, ce n’est que nous ». Autrement dit, au point de départ de l’histoire de l’Église, les Grecs et les Romains devenus chrétiens avaient conscience d’être greffés sur le peuple d’Israël, sur le fondement de l’apostolicité « juive » de l’Église.
Peu à peu cette perception s’est transformée jusqu’à percevoir l’Église comme un peuple se substituant au peuple d’Israël. Cette théorie de la substitution est pourtant contredite par saint Paul qui parle des chrétiens issus du paganisme (les non-juifs) comme des branches sauvages greffées sur le peuple d’Israël (Rm 11). Quand l’Église est tentée de l’oublier, elle court le risque de se couper de ses racines :
« Sans l’Ancien Testament, le Nouveau Testament serait un livre indéchiffrable, une plante privée de ses racines et destinée à se dessécher »[2].
Les premiers chrétiens avaient probablement une conscience plus forte de la nouveauté apportée par le Christ, mais aussi de la continuité et donc de la cohérence de l’histoire sainte. Il nous revient, aujourd’hui, d’approfondir la conscience de l’unité de la Révélation divine.
C’est à cela que saint Jean-Paul II n’a cessé d’encourager les chrétiens. Il a notamment rappelé que le lien qui unit l’Église au peuple juif est à l’image de la relation entre l’Ancien et le Nouveau Testament :
« De même que les deux parties de la Bible sont distinctes mais étroitement liées, de même le peuple juif et l’Église catholique »[3].
Sa visite de la grande synagogue de Rome le 13 avril 1986 a été le signe visible d’un nouvel esprit de fraternité. Sa phrase fameuse – « vous êtes nos frères préférés et, d’une certaine manière, on pourrait dire nos frères aînés » – en est l’expression emblématique.
Pour les premiers chrétiens, Jésus n’était donc pas le fondateur d’une nouvelle religion, mais le Messie qui accomplit les promesses faites à Israël.
Si, comme le dit saint Jérôme, « ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ », on peut ajouter qu’ignorer les racines juives de la foi chrétienne, c’est ignorer le Christ. Que tous soient plein du désir de découvrir ces racines pour mieux vivre de la foi au Christ.